L’introduction d’un placebo est fréquente. Pourtant, s’il peut, chez certains patients, jouer le rôle d’une véritable substance, il n’a pas de réelle efficacité pharmacologique. Aussi, dans le soin comme dans la recherche, son usage sur le plan éthique peut questionner. Le patient est en droit de recevoir toutes les informations le concernant, notamment les substances qui lui sont administrées.
L’utilisation du placebo est-elle « malhonnête », constitue-t-elle une tromperie ? Cette réflexion nous conduira également à aborder les relations entre le corps et la subjectivité.
Situation
À chacune de ses visites pour réaliser un détartrage de routine, M. Martin réclame une anesthésie de l’ensemble de ses maxillaires. Je ne suis pas disposé à répondre à cette demande que je trouve exagérée. De plus, un simple coton salivaire trempé dans de l’eau passé sur ses gencives, et présenté comme un nouveau médicament potentiellement analgésique, suffit à le tranquilliser et à réduire son inconfort lors des soins. Ainsi, je cache la vérité à mon patient.
Pour autant, je sais qu’il n’existe aucune raison scientifique, éthique ou juridique de ne pas l’informer de l’existence d’une substance inerte sur le coton. Cependant, si M. Martin savait que j’utilisais ce placebo, l’efficacité du traitement diminuerait ou il la rejetterait.
Aussi, je me demande quel est le risque encouru par les patients auxquels un placebo est administré. Cela se justifie-t-il comme une exception d’un point de vue éthique ?
Dans un cadre plus général, aurais-je le droit d’administrer un placebo à un patient qui a besoin d’une substance active ?
Réflexions du Docteur Jean-Christophe Fricain
Professeur des Universités, Praticien Hospitalier
UFR des Sciences Odontologiques de l’Université de Bordeaux
L’effet placebo est l’effet d’une substance pharmacologiquement inactive administrée en lieu et place d’un traitement actif. Cet effet peut être positif ou négatif pour le patient qui le traduit en effet bénéfique ou en effet indésirable parfois similaire à un médicament actif. La prescription d’un placebo relève de deux types de pratiques : les essais cliniques et le soin courant.
Dans le soin courant, le placebo est prescrit au malade pour lui plaire, au sens étymologique du terme. En prescrivant un placebo, le médecin ou le chirurgien-dentiste a l’impression de respecter l’éthique médicale qui est dominée par le primun non nocere (« en premier, ne pas nuire »). Le thérapeute espère, par le biais de sa prescription, améliorer les symptômes de son patient, qu’il juge insuffisants pour un traitement allopathique ou parce qu’il n’a pas d’étiologie précise et que le patient est en demande de traitement. Si l’on peut facilement admettre l’innocuité du placebo sur une pathologie bénigne qui évoluera spontanément vers la guérison, il n’en est pas de même pour les pathologies chroniques. L’exemple de la stomatodynie est criant dans le domaine odontologique. Les patients reçoivent souvent des traitements inadaptés qui agissent via un effet placebo pendant quelques semaines avant disparition de cet effet. L’espoir de l’amélioration déchu fait tomber le patient de Charybde en Scylla. Il en résulte une déception qui augmente son angoisse, ce qui majore sa douleur et la pérennise. Dans cette situation, prescrire un placebo n’est pas éthique, car il n’y a pas d’effet à long terme du traitement. De plus, prescrire un placebo en intention de traiter place le praticien dans une situation dominante qui ne respecte pas le devoir d’information. Pour toutes ces raisons, je répondrais que prescrire un placebo pour traiter un patient n’est pas éthique.
Dans le cadre d’un essai clinique, la prescription d’un placebo est justifiée pour évaluer l’effet pharmacologique du traitement à l’étude. Dans le cadre d’une dentisterie et d’une médecine fondées sur la preuve, le recours à un traitement placebo témoin est souvent nécessaire. Dans le cadre de ces essais cliniques, le patient est informé qu’il est susceptible de prendre un placebo pendant la durée de l’étude. La participation à une étude clinique contenant un placebo est basée sur le volontariat. De plus, le caractère éthique de l’étude est évalué par un comité de protection des personnes qui récusera le placebo s’il n’est pas justifié en fonction du rapport bénéfice/risque. Dans ce contexte, dans le strict respect de la loi de bioéthique sur les essais cliniques, la prescription du placebo me semble éthique.
Réflexions du Professeur Didier Raoult
Professeur des Universités, Praticien Hospitalier
Laboratoire de Bactériologie-Virologie, Hôpital de la Timone, Marseille
La question posée est d’une extrême importance. Il existe deux types de placebos, les placebos dont l’effet est conscient et ceux dont l’effet est inconscient.
Pour les placebos dont l’effet est inconscient, le fait de mentir aux malades n’a pas d’importance. En effet, il a été montré, par exemple pour les injections de morphine, que si l’on fait une injection de morphine tous les jours du lundi au vendredi et que l’on injecte au patient un composé sans morphine le samedi à la même heure, il aura la même réaction, bien qu’il sache qu’il n’y a pas de morphine. Ce qui est un phénomène complexe à comprendre, mais qui a été démontré.
Pour l’effet placebo conscient, la situation est complexe, car le malade doit croire que l’on présente un traitement efficace. Globalement, deux attitudes sont possibles : une attitude dite « paternaliste » qui consiste à cacher qu’il s’agit d’un effet placebo, et une croyance dans des thérapies alternatives sans support identifié qui n’oblige pas le praticien à mentir, même si on ne connaît pas d’autres effets thérapeutiques que l’effet placebo à ces traitements. C’est le cas de la sophrologie, ou de l’hypnose, voire de l’homéopathie, thérapeutiques dans lesquelles le praticien croit en son traitement même si d’autres n’y croient pas, ce qui lui permet de le prescrire, de bénéficier d’un effet placebo, sans avoir à mentir.
Il n’y a pas de solutions idéales et il est clair qu’il existe de ce point de vue des éléments culturels. Ainsi, un travail récent dans le Lancet a montré que les Anglais et les Américains mettent en premier dans leur relation médecins-malades l’autonomie du malade, c’est-à-dire que les malades refusent qu’il leur soit menti « pour leur bien », tandis que les Européens continentaux mettent en premier l’efficacité plus que l’autonomie (pourvu que cela marche).
Ensuite, le choix de donner ou de ne pas donner de placebos, tout en sachant qu’il n’y a pas de principes actifs est un choix de pratique thérapeutique personnel pour lequel il n’existe pas de solutions simples.
Réflexions du Professeur Didier Raoult
Professeur des Universités, Praticien Hospitalier
Laboratoire de Bactériologie-Virologie, Hôpital de la Timone, Marseille
La question posée est d’une extrême importance. Il existe deux types de placebos, les placebos dont l’effet est conscient et ceux dont l’effet est inconscient.
Pour les placebos dont l’effet est inconscient, le fait de mentir aux malades n’a pas d’importance. En effet, il a été montré, par exemple pour les injections de morphine, que si l’on fait une injection de morphine tous les jours du lundi au vendredi et que l’on injecte au patient un composé sans morphine le samedi à la même heure, il aura la même réaction, bien qu’il sache qu’il n’y a pas de morphine. Ce qui est un phénomène complexe à comprendre, mais qui a été démontré.
Pour l’effet placebo conscient, la situation est complexe, car le malade doit croire que l’on présente un traitement efficace. Globalement, deux attitudes sont possibles : une attitude dite « paternaliste » qui consiste à cacher qu’il s’agit d’un effet placebo, et une croyance dans des thérapies alternatives sans support identifié qui n’oblige pas le praticien à mentir, même si on ne connaît pas d’autres effets thérapeutiques que l’effet placebo à ces traitements. C’est le cas de la sophrologie, ou de l’hypnose, voire de l’homéopathie, thérapeutiques dans lesquelles le praticien croit en son traitement même si d’autres n’y croient pas, ce qui lui permet de le prescrire, de bénéficier d’un effet placebo, sans avoir à mentir.
Il n’y a pas de solutions idéales et il est clair qu’il existe de ce point de vue des éléments culturels. Ainsi, un travail récent dans le Lancet a montré que les Anglais et les Américains mettent en premier dans leur relation médecins-malades l’autonomie du malade, c’est-à-dire que les malades refusent qu’il leur soit menti « pour leur bien », tandis que les Européens continentaux mettent en premier l’efficacité plus que l’autonomie (pourvu que cela marche).
Ensuite, le choix de donner ou de ne pas donner de placebos, tout en sachant qu’il n’y a pas de principes actifs est un choix de pratique thérapeutique personnel pour lequel il n’existe pas de solutions simples.

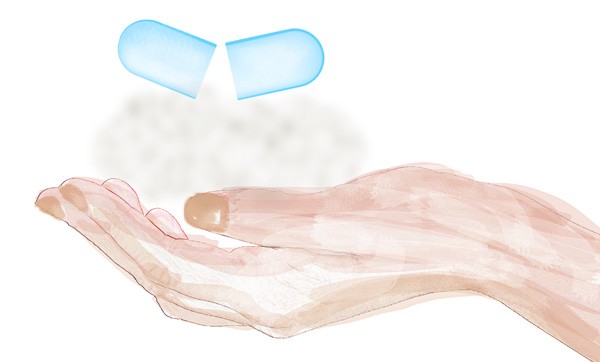












Commentaires